Le dessalement au cœur de la souveraineté hydrique et énergétique du Royaume
Le projet d’extension de l’usine de dessalement d’Agadir franchit une nouvelle étape majeure avec l’entrée d’AMEA Power, l’un des développeurs les plus dynamiques du secteur des énergies renouvelables en Afrique. Cette deuxième phase, réalisée en partenariat avec le groupe espagnol Cox, permettra de porter la capacité de l’installation à 400 000 m³/jour, positionnant Agadir parmi les plus grandes unités de dessalement du continent africain.
Cette avancée s’inscrit dans une stratégie intégrée, combinant énergies renouvelables et accès à l’eau, dans un contexte de pression croissante sur les ressources hydriques. Alimentée par un parc éolien de 150 MW à Laâyoune, cette infrastructure marque également la première incursion d’AMEA Power dans le secteur du dessalement au Maroc et en Afrique du Nord.
Une alliance stratégique pour une infrastructure intégrée eau-énergie
Ce projet est le premier déploiement opérationnel issu de la coentreprise Water Alliance Ventures, née d’un partenariat signé en mai 2025 entre AMEA Power et Cox, spécialiste mondial de la gestion de l’eau et de l’énergie.
L’ambition affichée de cette alliance est de concevoir, financer et exploiter des infrastructures co-localisées qui allient production d’énergie renouvelable et usines de dessalement. Le projet d’Agadir, par son ampleur et son caractère structurant, sert ainsi de projet pilote pour un modèle reproductible à l’échelle continentale, notamment en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
400 000 m³/jour : une capacité record pour l’Afrique
L’extension de l’usine d’Agadir permettra d’atteindre une capacité de traitement de 400 000 m³ par jour, soit près de 146 millions de mètres cubes par an. Ce volume place l’unité parmi les plus importantes d’Afrique, et lui confère un rôle stratégique pour l’approvisionnement en eau potable et agricole de toute la région du Souss-Massa, particulièrement affectée par les sécheresses successives.
Cette montée en capacité interviendra dans un contexte où le Maroc, comme de nombreux pays de la région MENA, fait face à une raréfaction des ressources hydriques conventionnelles, alors même que la demande en eau ne cesse de croître sous l’effet de la croissance démographique et du développement agricole.

Une alimentation 100 % renouvelable par un parc éolien à Laâyoune
La grande originalité de cette deuxième phase réside dans sa source d’énergie renouvelable dédiée : le projet sera alimenté par un parc éolien de 150 MW, actuellement en cours de développement par AMEA Power à Laâyoune.
Ce lien direct entre production d’eau dessalée et électricité verte permet :
- De réduire considérablement l’empreinte carbone de l’installation ;
- De diminuer les coûts d’exploitation à long terme ;
- Et de renforcer la sécurité énergétique du projet, en limitant la dépendance au réseau national.
Le parc éolien devrait être mis en service en 2027, soit quelques mois après l’entrée en exploitation de la nouvelle tranche de l’usine, prévue fin 2026.
Un investissement structurant de plus de 250 millions d’euros
Le montant cumulé de l’investissement, combinant l’extension de l’usine de dessalement et la construction du parc éolien associé, dépasse les 250 millions d’euros. Cette somme reflète :
- La complexité du projet ;
- Le caractère intégré de sa conception ;
- Et la volonté des partenaires de s’inscrire dans la durabilité économique et environnementale du long terme.
Il s’agit également de l’un des investissements les plus importants réalisés récemment dans le secteur de l’eau au Maroc, hors grands barrages et projets hydrauliques.
AMEA Power renforce son ancrage stratégique au Maroc
Ce projet symbolise la montée en puissance d’AMEA Power au Maroc, devenu un marché clé dans sa stratégie africaine. L’entreprise, basée à Dubaï, développe déjà plusieurs projets d’énergies renouvelables dans le Royaume et affiche une volonté claire de soutenir les objectifs marocains en matière :
- De sécurité hydrique ;
- De transition énergétique ;
- Et de développement durable régional.
« Ce projet traduit notre ambition d’apporter des solutions intégrées aux défis conjoints de l’eau et de l’énergie. Il illustre aussi la puissance des partenariats de long terme pour faire avancer un développement durable à grande échelle », a déclaré Hussain Al Nowais, président d’AMEA Power.
Dessalement et résilience climatique : un duo d’avenir
Face aux changements climatiques, le dessalement couplé aux énergies renouvelables apparaît comme une solution incontournable pour les pays du Sud confrontés à une baisse des précipitations et à la salinisation des nappes. Le modèle d’Agadir-Laâyoune :
- Réduit les tensions sur les ressources naturelles ;
- Diminue l’intensité carbone de la production d’eau douce ;
- Et permet une adaptation proactive aux risques climatiques.
En couplant planification énergétique et politique de l’eau, le Maroc démontre une nouvelle fois sa capacité à anticiper les défis structurels liés à son développement.
Un modèle exportable à l’échelle régionale
Au-delà du cas marocain, Water Alliance Ventures ambitionne de dupliquer ce modèle dans d’autres pays confrontés à des contraintes similaires. Plusieurs projets sont déjà en étude au Moyen-Orient, en Afrique de l’Ouest et dans la Corne de l’Afrique.
Ce couplage stratégique entre eau et énergie, autrefois géré en silos, devient une logique d’investissement unifiée, plus lisible pour les bailleurs, plus efficace pour les opérateurs, et plus durable pour les territoires concernés.
Conclusion : un tournant pour la politique de dessalement au Maroc
Avec cette extension à 400 000 m³/jour, le projet d’Agadir marque un tournant historique dans la politique de dessalement du Royaume. Il associe des partenaires de référence, une technologie éprouvée et une stratégie intégrée, à l’heure où le Maroc cherche à renforcer sa résilience hydrique tout en respectant ses engagements climatiques.
Cette initiative démontre que l’avenir de l’eau passera nécessairement par des modèles hybrides, flexibles et écologiquement responsables, à la croisée des chemins entre technologie, gouvernance et coopération régionale.
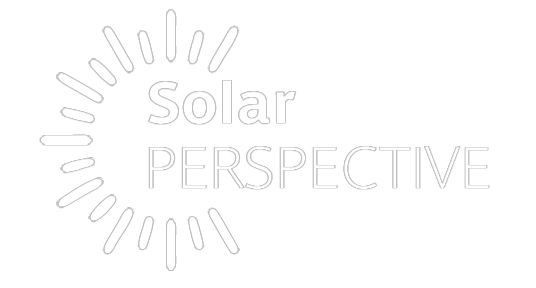
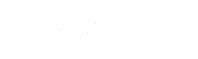










Leave a Reply